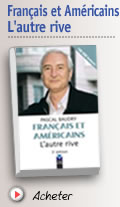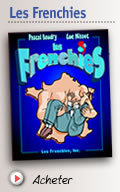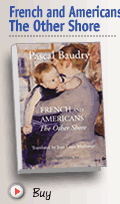Futuribles - Mai 2002
Futuribles - Mai 2002
L'antiaméricanisme à la française
Mais qu'ont donc fait les Américains aux Français ?
L'antiaméricanisme est une tradition bien française. C'est ce qu'a voulu montrer Michel Drancourt en analysant pour Futuribles une série d'ouvrages soigneusement sélectionnés.
- Le premier ouvrage, L'Ennemi américain de Philippe
Roger (2), une généalogie de l'antiaméricanisme à
la française, nous rappelle que le Nouveau Monde a, très tôt,
été l'objet de nombreux préjugés. Mépris,
dénigrement, les Français n'ont jamais caché leur hostilité
envers cet impérialisme conquérant qui se veut universel.
- Le deuxième ouvrage, Après l'empire d'Emmanuel
Todd (3), est un essai sur la décomposition du système américain
et le parti pris français antiaméricain. Tout ce qui vient des
États-Unis ne peut être que désastreux à terme.
Les Français y dénoncent cette Amérique soucieuse de
ses intérêts, qui se veut le garant d'une organisation mondiale.
Et d'ajouter que cette Amérique capitaliste, dépendante du reste
du monde est elle-même condamnée à terme.
- Le troisième ouvrage, The Paradox of American Power de Joseph S. Nye Jr (4), cherche à convaincre les États-Unis
que s'ils interviennent seuls dans le règlement des affaires étrangères,
ils continueront d'être perçus comme coercitifs et arrogants.
L'ordre international doit être un bien public pour le bénéfice
de tous.
- Le quatrième ouvrage, Reconcilable Differences (5), plaide pour une réanimation de l'alliance franco-américaine.
Les tensions, bien que d'origine économique, tiennent à des
différences conceptuelles. Les auteurs militent pour une meilleure
connaissance et compréhension mutuelles, et tentent de convaincre les
alliés d'agir ensemble.
- Un dernier ouvrage, L'Autre Rive. Comprendre les Américains pour comprendre les Français de Pascal Baudry (6), analyse les comportements américains et français en entreprise, en vue de contribuer à un rapprochement des uns et des autres, et de leur apprendre ainsi à mieux travailler ensemble. Si l'hégémonie suscite rarement l'affection, Michel Drancourt attire néanmoins notre attention sur l'ouvrage de Jean-François Revel (7), qui dénonce cette « obsession antiaméricaine ».
C.B.
(1) Économiste, membre du comité de rédaction de Futuribles.
(2) ROGER Philippe. L'Ennemi américain. Généalogie de l'antiaméricanisme
français. Paris ; Seuil (colt. La Couleur des idées), 2002, 601
p.
(3) TODD Emmanuel. Après l'empire. Essai sur la décomposition
du système américain. Paris ; Gallimard (colt. Blanche), 2002,
233 p.
(4) NYE Jr Joseph S. The Paradox of American Power: Why the World's Only Superpower
Can't Go It Alonc. New York ; Oxford University Press, 2002, 240 p.
(5) BRENNER Michael, PARMENTIER Guillaume. Reconcilable Differences. US-French
Relations in the New Era. Washington : Brookings Institution Press, 2000, 208
p.
(6) Paris : Village mondial, à paraître en janvier 2003 ; paru
en cyberlivre en 2002 (site Internet www.wdhb.com/cyberlivre/) ; extraits parus dans Business Digest, septembre 2002.
(7) REVEL Jean-François. L'Obsession antiaméricaine. Son fonctionnement,
ses causes, ses inconséquences. Paris : Pion, 2002, 299 P.
(8) Géographe hollandais, auteur des Recherches philosophiques sur les
Américains (Berlin, x768-69) (NDLR).
(...)
L'autre riveL'ouvrage qui éclaire le mieux tout ce qui vient d'être dit est celui de Pascal Baudry, L'Autre Rive. Comprendre les Américains pour comprendre les Français. L'auteur, français, marié à une Américaine, a créé un cabinet de conseil à Berkeley pour notamment aider les entreprises européennes à mieux connaître les États-Unis.
Il part d'un constat d'évidence qui explique beaucoup l'antiaméricanisme français : les deux pays ont des cultures à visée universelle. La France l'avait avant même la création des États-Unis ; elle lui en veut de lui avoir ravi la vedette, Pour faire comprendre les différences, Pascal Baudry examine les problèmes qui se posent quand il s'agit de faire travailler Américains et Français sur un projet commun.
Les Américains font preuve d'un optimisme quasi forcené qui découle de leur éducation ; dès leur plus jeune âge, ils sont encouragés à agir. En France, les jeunes sont soumis à la critique, à la prudence, ce qui s'explique par l'histoire de la vieille Europe longtemps soumise à la disette et aux risques provoqués par la rareté ; d'où sans doute, aussi, les réticences à l'égard de l'entreprise privée et du profit.
Les États-Unis, pays de tradition protestante, tiennent la responsabilité individuelle pour primordiale. La France, elle, préfère la réglementation. Son niveau de réglementation administrative est d'ailleurs le plus élevé des 20 pays les plus développés. Aux États-Unis, les rapports entre personnes et groupes sont régis par des contrats dont chaque détail a été négocié, et dont l'application entraîne fréquemment le recours à un avocat et à la justice, les litiges se terminant généralement par des règlements à l'amiable. En France, le contrat est plutôt perçu comme une déclaration d'intention dont les détails sont à préciser ultérieurement.
Dans le domaine professionnel, les Américains se concentrent sur la réalisation d'une tache. Les Français s'attachent au milieu de travail, où ils cherchent à se faire remarquer par leurs diplômes ou leur tempérament ; alors que pour les Américains, ce qui compte c'est le savoir-faire et la réalisation d'un objectif bien défini - cela commence à l'école, où l'on apprend à travailler ensemble (maîtres et élèves réunis) à l'obtention d'un résultat utile pour les différentes parties.
Les Français se situent encore souvent dans des relations de vassal
à suzerain. Aux États-Unis, on dit clairement ce qu'on a à
dire. En France, les paroles sont souvent empreintes d'arrièrepensées.
Il est vrai que le partage d'informations n'y est pas naturel. Enfin, l'Amérique
est un pays qui s'aime et Pascal Baudry doute que ce soit le cas de la France,
même si les Français ont tendance à considérer leur
pays comme plus « civilisé » que les États-Unis.
Le mot de la fin est de Stanley Hoffmann '6 qui demande « pourquoi n'aime-t-on
pas l'Amérique ? jamais dans l'histoire une puissance hégémonique
n'a pu être «aimée", personne rte chérissant
la puissance d'un autre. Une superpuissance peut être obéie (cas
de l'Empire romain ou britannique) et tout an plus admirée (cas de la
France), mais l'aflection ne fait pas partie du comportement d'un État.
« Une nouvelle civilisation était en train de naître; on ne l'avait pas désirée, elle n'était pas le fruit de projets précis. on ne l'avait pas prévue. te Nouveau Monde avait simplement ébranlé les traditions de la Vieille Europe. » Daniel Boorstin. in Histoire des Américains. Paris : Robert Laffont (col]. Bouquins), 1991.
Michel Drancourt (1)