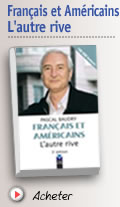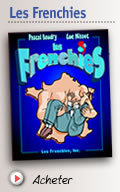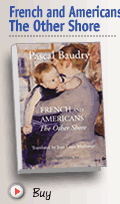Le Figaro Magazine - Mai 2003
France/Etats Unis: nos liaisons dangereuses
Pascal Baudry, résident à Berkeley, en Californie, fondateur de WDHB Consulting Group et professeur au MBA de l' Ecole nationale des ponts et chaussées, publie "Français & Américains : l'autre rive", aux éditions Village Mondial/Pearson.
Vous êtes français et établi aux Etats-Unis ; votre principale activité aujourd'hui est d'aider vos compatriotes à mieux comprendre les Américains...
En effet. J'ai d'abord exercé le métier de psychanalyste avant de devenir cadre dirigeant, d'abord en France puis aux Etats-Unis, où j'ai créé une société de conseil s'adressant aux entreprises européennes désireuses de réfléchir à leur stratégie outre-Atlantique. J'ai fondé une famille il y a ving tcinq ans avec une femme américaine : mes enfants, nés en France, sont devenus américains, et ma vie de couple a été un premier terrain d'observation. Ainsi, dans le couple américain, pour éviter de fâcher l'autre, une déclaration d'amour appellera instantanément une déclaration similaire : « I love you » - « I love you, too » de façon quasi machinale - ce qui peut nous paraître un peu niais ou pesant. Dès qu'on a fait une plaisanterie, il convient d'en avertir l'autre : « It's a joke ! » ou « I'm kidding ! ». De même encore, si, le mardi, vous dites à vos enfants que vous les emmènerez au zoo le dimanche, ils vous attendront de pied ferme au matin du jour dit ; car différer la promenade reviendrait pour eux à renier la parole donnée. Les Français, plus sensibles à l'air du temps, à la fantaisie de l'instant, ou simplement moins rigoureux, sont bien vite décalés dans un tel univers. Alors que les Français vivent dans l'implicite, les Américains, eux, sont dans l'explicite. La nonne made in (USA veut que le mot égale la chose. C'est parfaitement logique si l'on songe que ce peuple s'est formé à partir d'immigrés venus de la planète entière : il fallait apporter à ceux qui posaient des questions dans un mauvais anglais des réponses simples et claires pour qu'ils puissent en tirer profit. C'est ainsi qu'en deux siècles et demi l'on est passé de l'une des cultures les plus implicites du monde, l'anglaise, à l'une des plus explicites, l'américaine. D'où les malentendus qui émaillent constamment les relations entre Américains et Britanniques. Les Français n'y échappent pas non plus. Parce que nos compatriotes connaissent les mœurs, les produits et le continent américains, ils auraient tendance à s'estimer proches de ce peuple, alors que, toutes proportions gardées, ils ressemblent davantage aux Japonais !
La population française s'est pourtant, elle aussi, constituée par vagues d'immigration...
Oui, mais elle attend de ceux qui souhaitent la rejoindre qu'ils fournissent les efforts nécessaires à leur assimilation : les Français n'expliquent pas leur code culturel aux autres, ils conservent une approche implicite. Et si notre langue a longtemps été celle de la diplomatie de par sa précision, paradoxalement, c'est qu'elle permet d'être le plus précisément imprécis ! L'implicite propre aux Français suppose de faire attention au sens, mais aussi à la relation avec l'interlocuteur. L'écoute est plurielle et contextuelle, à la différence de la communication américaine qui tente de se dépouiller de tout ce qui n'a pas strictement trait au message que l'on entend faire passer, par des phrases courtes. Les Américains sont capables de travailler durablement dans des bureaux sans fenêtres, contrairement à nous, qui avons besoin de savoir que le contexte est là. Et notre culture étant verticale (en dépit de la Révolution), la forme même de l'expression est un critère d'appréciation de l'autre, car notre façon d'être est éminemment critique.
D'où vient cette attitude ?
En grande partie de l'éducation. Un Français est critiqué plus de cent mille fois au cours de son enfance, tant par sa famille que par ses enseignants, et le jugement porte sur qui il est (ce qui paraît irréversible), et non, à l'américaine, sur ce qu'il fait. A partir de là, il se crée une cuirasse qui lui permet de répliquer le modèle en se convainquant que s'il se met à critiquer les autres, il ne sera pas lui-même critiqué : avoir raison implique que l'autre a tort. De part et d'autre de l'Atlantique, la construction du noyau de personnalité évolue selon des schémas différents. Et cela dès la naissance. Chez nous, les cliniques d'accouchement favorisent la fusion mère-enfant. Aux Etats-Unis, elles les considèrent d'emblée comme des êtres séparés. Par la suite, les mères françaises et américaines adoptent une position opposée par rapport à leur progéniture. Lorsqu'un gamin va au square, la mère américaine le poussera toujours à aller jouer, elle lui laissera toute liberté, alors que la mère française commencera par l'abreuver de conseils : « Ne te salis pas », « Ne va pas trop loin », « Fais attention à ne pas tomber », etc. Si le petit Américain revient après avoir reçu un coup d'un camarade, sa mère le réconfortera, lui expliquera quoi faire la prochaine fois, et le renverra d'une formule lapidaire, telle que « Go have fun » - « Allez, va jouer » -, tandis que la française, après avoir protesté - « Tu n'en fais qu'à ta tête » ou « Avec toi, c'est toujours la même chose », etc. - conclura par cette menace : « Ou tu restes près de moi, ou nous rentrons à la maison. »... Cette différence d'éducation se retrouve au niveau des personnalités adultes : l'expression très forte du « Go have fun » équivaut à un sevrage social précoce, une expulsion, qui conduit les Américains à se demander constamment s'il sont aimés ; on l'a vu en Irak ou ils s'attendaient à être reçus clans la liesse !
Est-ce pour cela qu'ils fréquentent tant les psychanalystes ?
Oui, et parce que leur éducation leur interdit la position dépressive. Dans le « Go, have fun », l'injonction de jouer vaut obligation de réussir. L'Américain n'a pas le choix de l'échec, de l'incapacité, de l'inertie, de l'inaction, du retour dans le giron de la mère. Au lendemain des attentats du 11 septembre, 62 % des Américains souhaitaient entrer en guerre, même si 61% d'entre eux ne savaient pas contre qui. Leurs films doivent toujours se conclure par le happy ending.
A l'inverse les Français, dont la mère les a retentis à ses côtés en les protégeant sur le terrain de jeu, en déduisent que, sans elle, ils ne valent pas grand-chose et ne peuvent rien faire. Cette situation recèle un message implicite d'incapacité et engendre un comportement d'éternel second, à la Poulidor, sauf pour une minorité qui en réchappe par l'héroïsme, l'entrepreneuriat, la créativité. L'appartenance au cocon de la famille, de l'entreprise ou de la « mère patrie » est à la fois délicieusement confortable et insupportable car, pour s'assurer de son indépendance, l'individu devra agir par foucades, comme des grèves, des révoltes, des dissensions passagères, pour ensuite mieux rentrer dans le rang, dans le « mol oreiller » des 35 heures, des avantages acquis, de l'exception culturelle.
Quels sont les principaux reproches adressés par les Américains aux Français, et vice versa ?
Les deux peuples se reprochent mutuellement leur arrogance : aux Américains celle qu'ils tirent de leur force, aux Français celle qu'ils tirent de leur intelligence, de leur histoire et de la verticalité de leur système. Dans un dîner parisien, on n'hésitera pas à faire étalage de ses relations, de son pouvoir et de sa culture, mais l'on considérera malvenu de faire allusion à sa fortune. La religion marque beaucoup le comportement américain : dans un dîner outre-Atlantique, chaque convive va très vite savoir combien pèse l'autre en dollars car, pour ces descendants de puritains, afficher sa fortune revient à témoigner qu'on a accompli les volontés de Dieu en faisant fructifier le nouvel Eden qu'il a confié au peuple des élus. Alors que, en France, le mensonge est considéré comme relativement bénin dans la mesure où le catholicisme, contrairement au protestantisme, permet de l'effacer par l'absolution, les Américains, eux, s'en tiennent toujours à ce qu'ils disent. Pour les wasp - white anglo-saxon, Protestant - le mensonge conduit en enfer !
Est-ce à dire que les Américains sont plus simples que les Français ?
Oui, mais, pour être franc, il faut admettre que les deux cultures sont assez schizophréniques car, si les Français pratiquent à grande échelle la dissociation entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, les Américains, eux. renouent sur la scène internationale avec la tradition de la domination coloniale anglaise antérieure à la révolution américaine, et ne se considèrent pas tenus par leurs propres lois. C'est un phénomène que l'on retrouve assez fréquemment chez les peuples qui, après
avoir été colonisés, ont gagné leur indépendance. Les Américains sont indéniablement un peuple hégémonique, ce qui est insupportable aux Français qui n'admettent pas de se trouver aux échelons inférieurs de la verticalité. La position de Bush, quand il déclare que tout ce qui n'est pas avec lui est contre lui, est emblématique de la position de son pays, même s'il ne représente que la petite minorité des néo-conservateurs, qui a confisqué le pouvoir au sein de ce qu'on pourrait qualifier de « dictature démocratique ».
Croyez-vous que nos relations vont être durablement altérées ?
Si le bon peuple américain a vite accepté que la France soit son bouc émissaire, alors qu'elle défendait les mêmes positions que la Russie et l'Allemagne, cela tient aux relations historiques très «fusionnelles»
qu'entretiennent les deux pays : cela me fait penser à deux frères qui, au sein de la famille, auraient de temps en temps besoin de faire des éclats pour mieux s'assurer qu'ils sont à une distance supportable l'un de l'autre avant de se réconcilier. Les Américains savent que les Français sont leurs parents, mais ont du mal à l'assumer car ces derniers cherchent continuellement à se rassurer sur leur capacité d'indépendance, et ne sont jamais là où on les attend. Il n'en reste pas moins que la tradition historique les rend indissociables, et c'est pourquoi l'actuelle phase de tension sera sûrement suivie d'un regain de cette affection ambiguë qu'ils se portent mutuellement. Mais les dirigeants américains ne toléreront pas une montée en puissance de l'Europe qui viendrait menacer leur hégémonie, et ils cher client à contrer les initiatives françaises dans ce domaine.
Que souhaiteriez-vous voir évoluer dans le paysage français ?
Je propose d'effectuer un tri entre les valeurs qui méritent d'être défendues au nom du génie français et celles qui entravent l'épanouissement du pays. La protection, la frilosité excessive, le refus de l'individuation par rapport à la meute nous conduisent à nous replier sur nous-mêmes, à penser petit, à nous désintéresser du bien commuai. Le Français a la pénurie chevillée au corps, il croit toujours que les autres réussissent à son détriment, alors que l'Américain se situe dans une optique d'abondance où il y a place pour la réussite de tous. La paralysie de notre justice stupéfie de l'autre côté de l'Atlantique : pour un scandale financier comme Enron, les premières décisions judiciaires sont intervenues dans un délai de onze mois, alors qu'il faut attendre douze, voire quatorze ans en France pour que la justice passe. Tout cela doit changer. Cela étant, le mouvement qui s'est amorcé chez nous il y a une vingtaine d'années progresse inexorablement. Actuellement, nous en sommes à la juxtaposition de l'ancien système et d'un nouveau, largement porté par les médias et inspiré de la société américaine. D'où une confusion, et aussi un risque assez sérieux d'explosion, du fait de la personnalité fondamentalement dépressive du Français. Maintenant, la société française est à la recherche du père symbolique, parfois sous la forme d'un homme providentiel comme Napoléon, qui rendrait toute sa place à la loi et « ferait le ménage » assez rapidement pour que la population n'ait pas à en souffrir. L'accélération de la modernité se fera sous la pression de l'Europe, laquelle, par exemple, est en train d'importer Lm droit et, des pratiques comptables inspirés des pratiques américaines. Qu'on le veuille ou non, tout cela va s'imposer à l'Etat français. Du fait de la globalisation la « performance » devient incontournable, et elle passe par une explicitation des résultats allant dans le sens de l'américanisation croissante de la société française. Faut-il s'en alarmer ? Au contraire. A condition de réfléchir à notre culture et de savoir en défendre les magnifiques particularités !
Français
et Américains, l’autre rive
Pascal Baudry, Editions Village mondial, 224 pages
Lire, gratuitement, la version électronique : www.pbaudry.com/